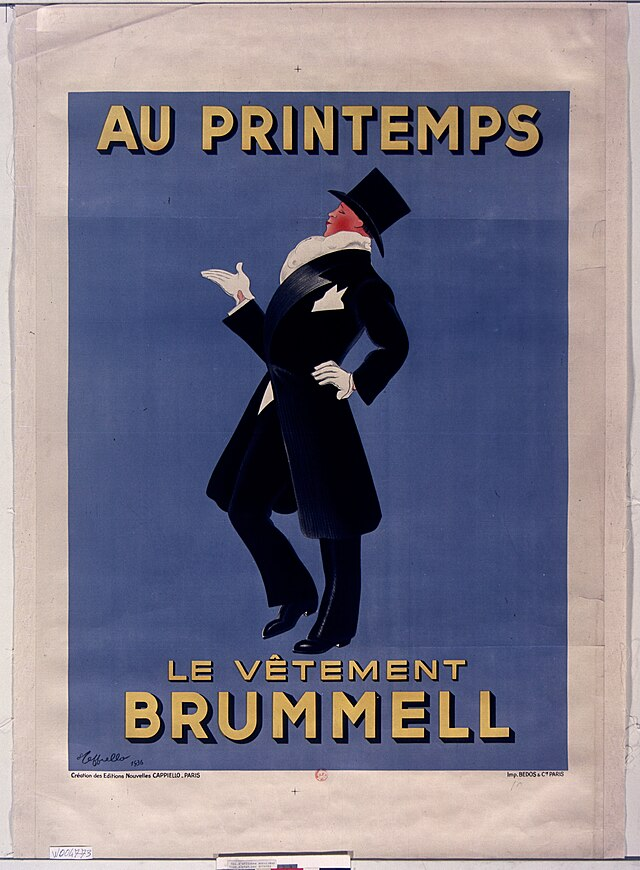Parisian Gentleman - © 2009-2020 - Mentions légales - Réalisé par HVLD digital
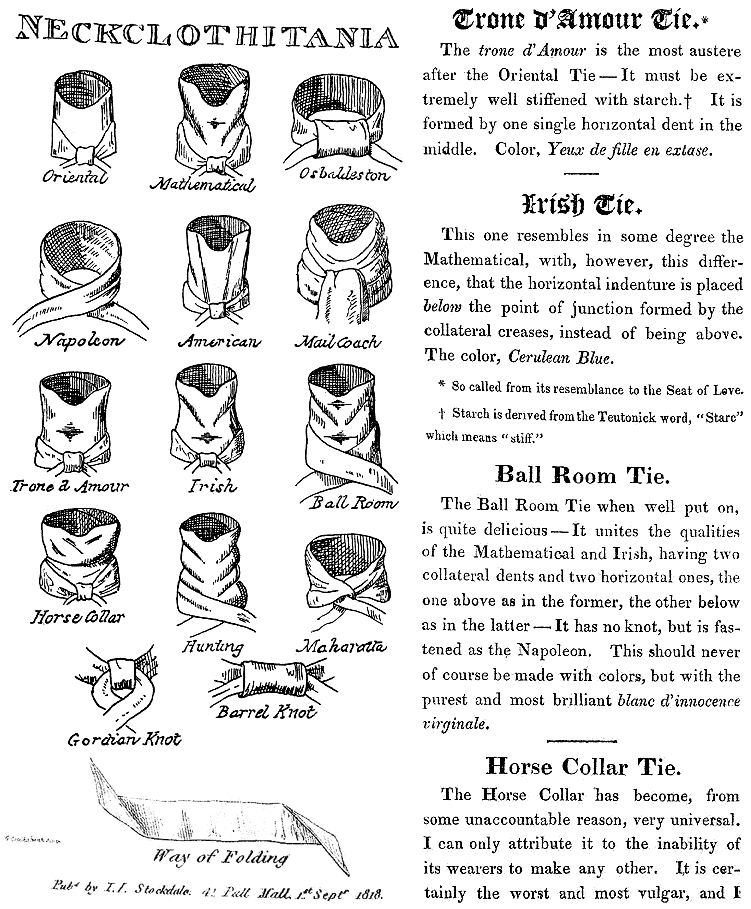
L’ébullition de nos médias ces derniers jours, à l’occasion de la visite du président Macron en Angleterre, n’a pas manqué de souligner l’élégance des participants. La notion de “style anglais” a été invoquée à plusieurs reprises, tandis que la sortie des grandes tenues de soirée a su heureusement surprendre. Mais quel est donc ce “style anglais” dont on entend tant parler, quand la conversation tombe sur l’art sartorial ? Et pourquoi la cravate semble-t-elle en constituer le centre de gravité ?
Enquête sur ce mythe de l’élégance, au pays de George Brummell et de Winston Churchill.
La cravate n’est pas d’origine anglaise : un certain consensus veut que ses racines soient européennes. Et si ce sont bien les Croates qui l'ont introduite en France, le goût moderne pour cet accessoire doit beaucoup, outre-Manche, aux Macaroni. Mais si l’on doit attribuer à quelqu’un la canonisation de la cravate, c’est bien à “Beau Brummell” - de son prénom, George. Celui-ci établit cet accessoire, encore balbutiant, comme un essentiel de la garde-robe du parfait gentleman.
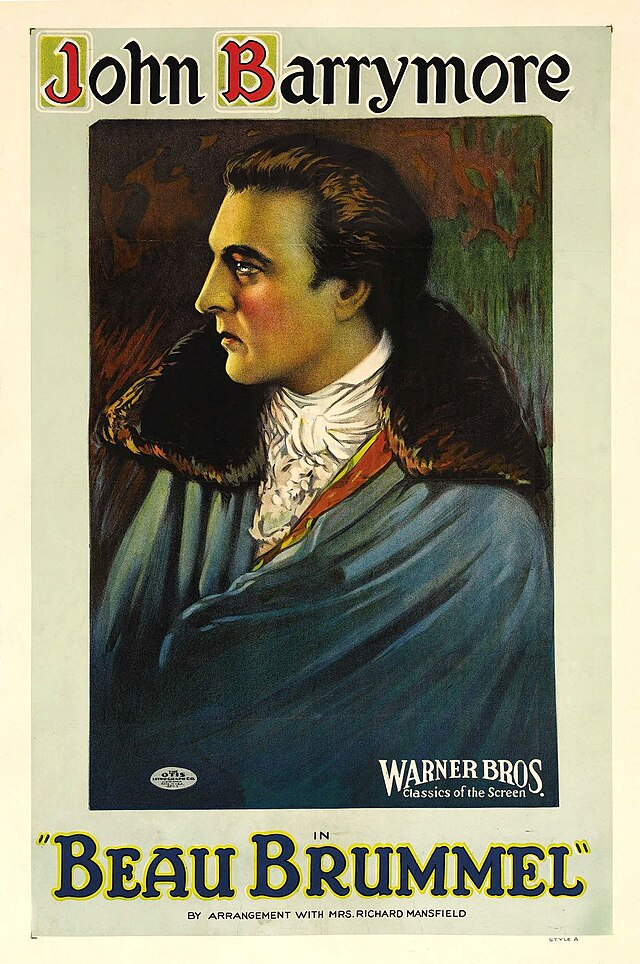
Même criblé de dettes et aux abois, le plus élégant des dandies persista à porter la cravate - mais comme les fonds manquaient pour payer son blanchisseur, il se mit, selon une anecdote bien connue, à les porter noires.
La publication de l’ouvrage Neckclothitania, en 1814, - en couverture de cet article - composera les commandements de ce culte nouveau : il s’agit d’un manuel de style, présentant quatorze manières de nouer sa cravate. Très vite, cet accessoire devient symbole d’élégance, mais aussi de richesse, et de valeur morale.
Les cravates à rayures - ou regimental ties - sont utilisées par les Britanniques pour signaler leur appartenance à un corps d’armée spécifique. C’est le cas, par exemple, de la Household division, qui présente une couleur bleue rattachée à la couronne royale, et une teinte écarlate symbolisant le sang de ceux qui sont morts pour la nation.

C’est ce style de cravate - également connu sous le nom de “cravate club” -, dont la rayure va de l’épaule gauche au flanc droit, qui va connaître un succès inattendu outre-Atlantique, lors de la visite du futur roi Edouard VII. Soit par volonté de se distinguer des regimental ties, soit par simple confusion, les cravates américaines à rayures présentent des motifs allant de l’épaule droite au flanc gauche. Ces dernières, créées par la maison Brooks Brothers à l’aube du XXe siècle, sont connues sous le nom de Repp tie.
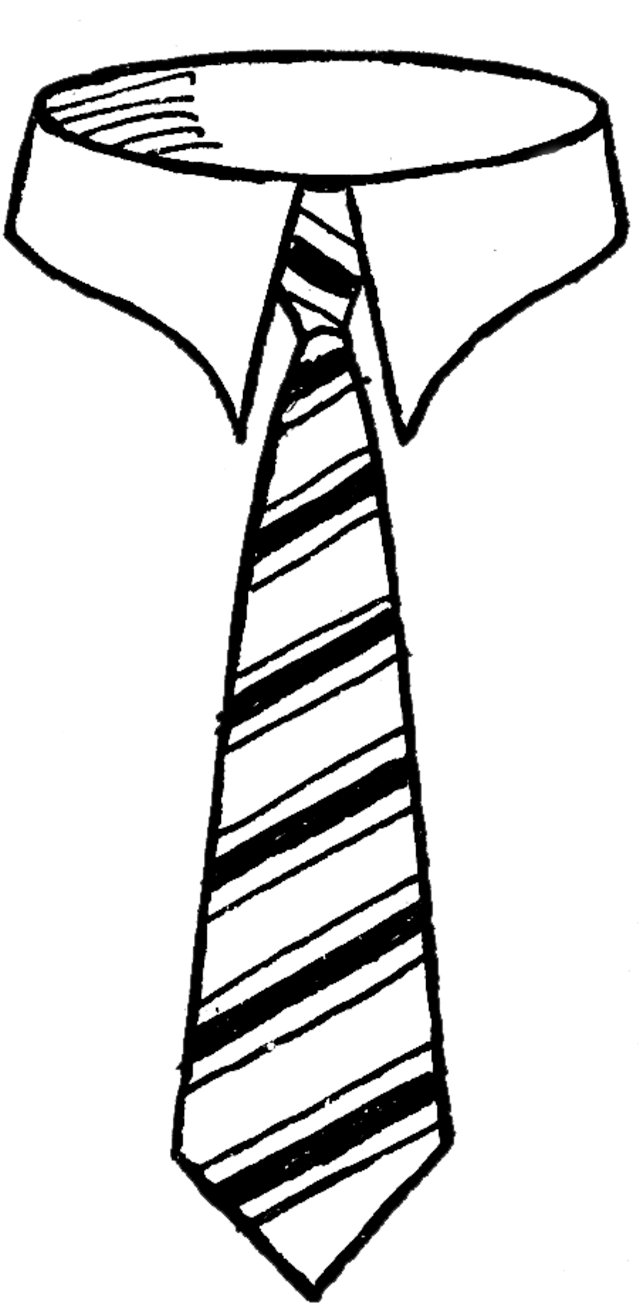
Ces cravates à rayures sont aussi utilisées dans les célèbres Colleges anglais, dont elles arborent les couleurs : elles deviennent alors les Collegiate ties.
Le tartan est l’un des motifs que l’on retrouve, le plus souvent, sur les cravates écossaises, voisines des Regimental ou des Repp ties. Des bandes horizontales et verticales s’entrecroisent, composant des motifs colorés connus sous le nom de “setts”. Le SRT (Scottish Register of Tartans), recense tous les motifs existants, et conserve aujourd’hui une part majeure de l’histoire du style en Grande-Bretagne.
Les racines britanniques des Etats-Unis font s’entrecroiser l’élégance des lords et celle des Américains. C’est notamment le cravatier new-yorkais Jesse Langdorf qui donne à la cravate sa forme contemporaine, dans l’entre-deux Guerres - nommée “bias”, aux Etats-Unis, et “cross-grain”, Outre-Manche.
C’est aussi aux Etats-Unis que la cravate tricot devient populaire, avant de revenir à l’envoyeur : elle est immédiatement adoptée au Royaume-Uni, et notamment par le célèbre groupe des Beatles. Dans les années 50, c’est la Kipper tie qui fait fureur, arborant des couleurs vives, des motifs géométriques, ainsi qu’une largeur insolente. Les stars de Rolling Stones, des Kinks ou des Mods, lui préfèrent la cravate fine, qu’ils mettent au pinacle de l’élégance provocatrice.

Nous pourrions évoquer ici les divers noeuds de cravate - Windsor et consorts -, mais c’est une autre histoire…
See you soon !